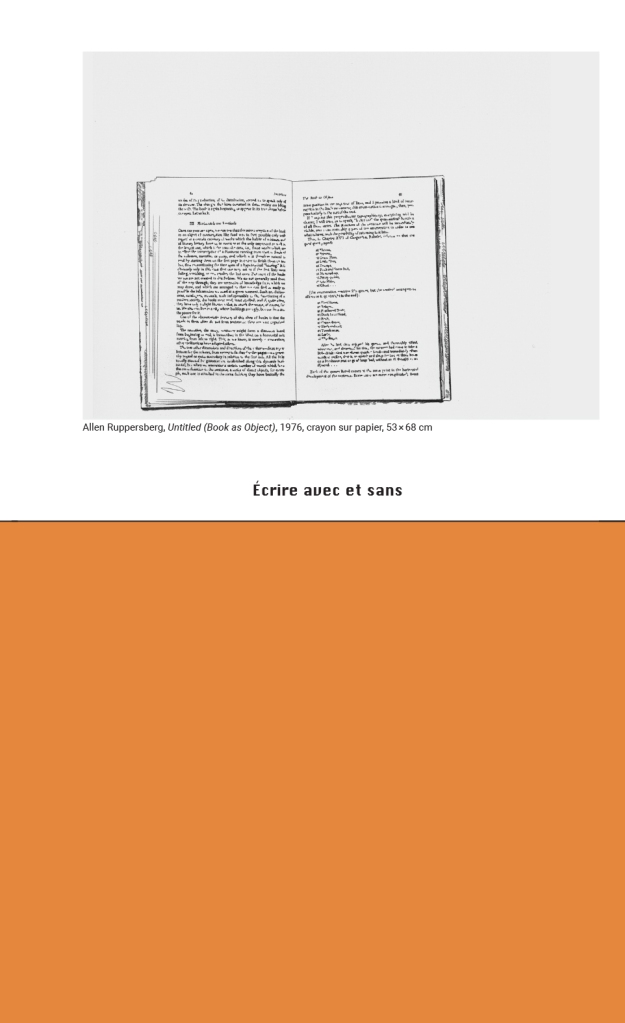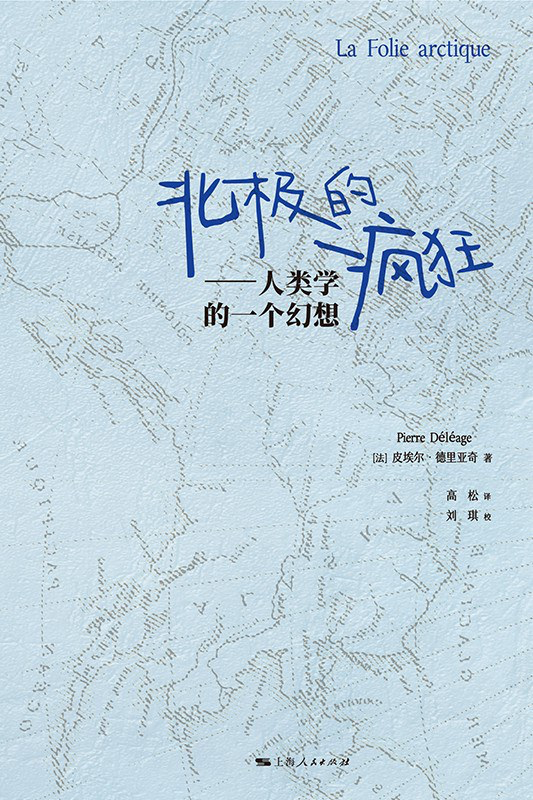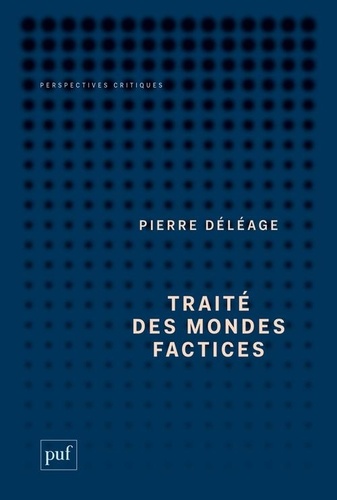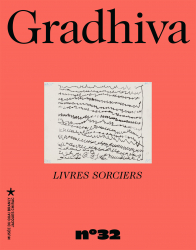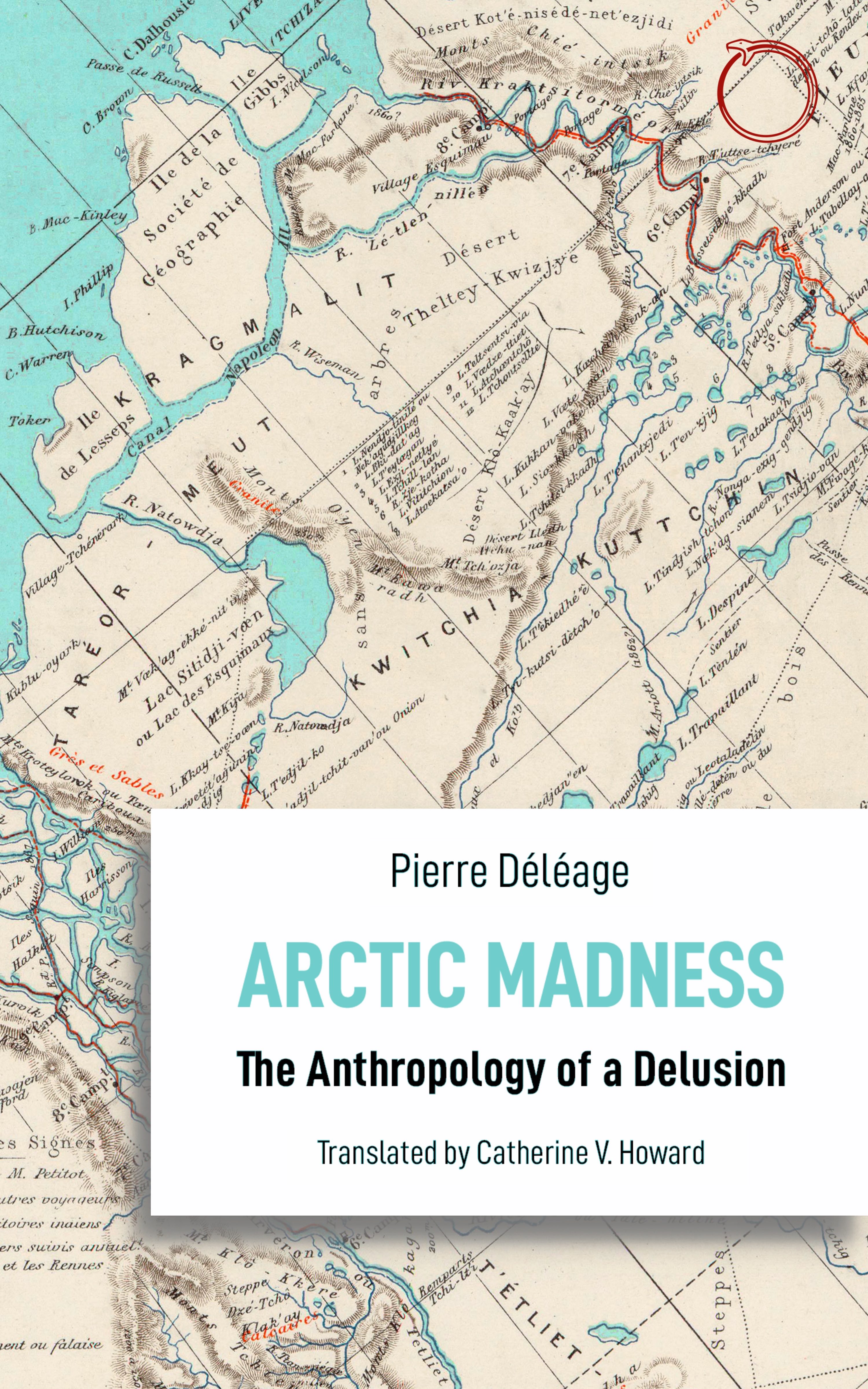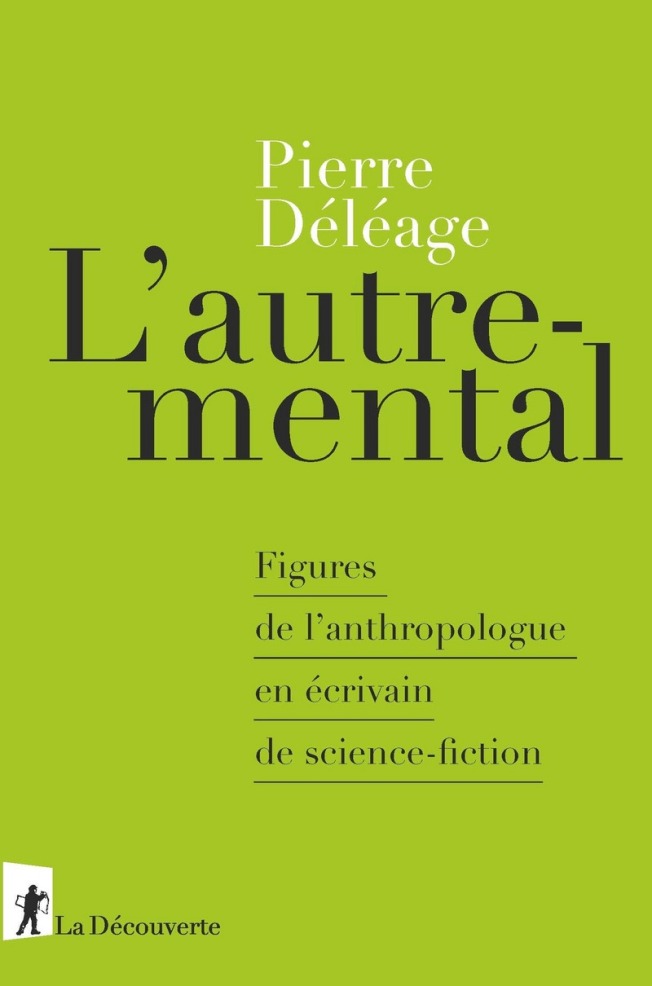J’ai créé ce site – selon la légende – le 21 décembre 2012, dans la foulée d’une enquête ethnographique chez les Mayas du Yucatán. Mais surtout à la suite – j’avais trente-six ans – d’une douloureuse période de plusieurs mois de remises en question tous azimuts. L’une d’entre elles avait trait à ma vocation d’anthropologue : une chose avait été de partir à l’autre bout du monde pour étudier dans des conditions rocambolesques des savoirs d’une complexité inouïe, de formuler des problématiques et des concepts destinés à en rendre compte, ou encore de découvrir une multitude d’environnements académiques internationaux au sein desquels le statut de précaire m’avait toujours permis de rester en marge ; une autre était désormais de travailler dans un petit bureau parisien, de prendre part à, voire même d’organiser, de fastidieux colloques, ou encore d’enseigner à des étudiants issus pour leur quasi-totalité de la classe supérieure. Je n’étais pas certain d’être à ma place.
De surcroît je me sentais de plus en plus à l’étroit dans les standards de publication académiques. Mes articles débordaient le plus souvent les sacro-saintes vingt pages autorisées, ils ne s’articulaient que très mal avec les courants et les styles dominants de l’anthropologie et il me fallait parfois les publier sous forme d’ouvrages, soit en regroupant deux textes qui n’avaient pas grand-chose à voir l’un avec l’autre (La Croix et les hiéroglyphes), soit en ajoutant, pour aboutir à une longueur décente, des annexes très moyennement utiles (Le Geste et l’écriture). Comme tout « jeune » chercheur, j’avais appris à deviner les attentes des comités de rédaction et je savais dorénavant aisément passer sous les – indispensables – fourches caudines de l’évaluation par les pairs. J’étais toutefois lassé par la lenteur du processus, par son étouffant conservatisme, par les passages obligés, par les citations réclamées ou encore par les (peu fréquents mais réels) barrages éditoriaux de mauvaise foi. J’avais l’impression d’avoir fait mes preuves et, tout en conservant les exigences de clarté et d’érudition auxquelles je me suis toujours astreint, je pensais pouvoir prendre maintenant un peu de liberté avec la forme d’expression de mes écrits. Mais alors quel pouvait être mon horizon de publication ? Aucun. C’est pourquoi je créai ce site.
Avec le recul et une vue globale sur son historique, je crois pouvoir distinguer deux périodes dans ses dix années d’existence. Pendant les cinq premières années, de 2012 à 2017, ce site est devenu mon moyen d’expression privilégié. Presque tous mes textes ont alors d’abord été publiés ici, « en temps réel » comme le précisait le sous-titre, « libérés de toute contrainte » comme l’indique encore crânement son À propos, c’est-à-dire sans contrainte d’écriture, pour moi, et sans contrainte d’accès, pour le lecteur. (C’était l’époque où une politique volontariste de libre accès allait de soi, où elle n’avait encore été massivement parasitée ni par les éditeurs commerciaux, qui aiment tant racketter les institutions académiques, ni par les agences ministérielles, qui aiment tant surveiller leurs employés). Indice de sa naissance impromptue en situation d’asphyxie imminente, le site s’intitula d’abord Un homme à la mer avant de devenir Trop tard, trop tôt, mélange de souvenirs cinéphiliques et de revendication un peu grandiloquente de l’inactualité de mes recherches. Ce fut un moment d’enthousiasme créatif, de bricolage éditorial et technique, de reprise de tous les recoins ethnographiques et conceptuels que j’avais dû laisser de côté, de découvertes et d’enquêtes sur des objets improbables, d’innovations formelles permanentes, de réflexivité radicale, quasiment dénuée de censure, autorisée et facilitée par la modalité du dialogue de soi à soi. Pendant les cinq années suivantes, de 2018 à aujourd’hui, l’expérience a trouvé ses limites et je n’ai plus publié de textes originaux que de loin en loin : la bouffée d’air avait été salvatrice et son influence s’est faite ressentir dans tous mes travaux ultérieurs, même les plus récents, toutefois la grande majorité de ce que j’écrivais désormais, articles ou livres, ne correspondait plus au format du site – qui est dès lors devenu un simple blog où je me contente d’annoncer leur parution.
J’ai considéré pendant longtemps ce site comme un petit monde autonome, un foyer confortable et rassurant, une monade à l’intérieur de laquelle pouvait se refléter le continuum assez étendu de mes intérêts changeants. Il ne communiquait guère avec l’extérieur : le seul commentaire dont j’autorisai la publication fut celui, stratégique, d’Edwin Reesink qui réorienta significativement mon enquête sur la Leçon d’écriture de Lévi-Strauss – je le remercie encore une fois. Peut-être de manière plus problématique, alors que les textes que j’y publiais respectaient toutes les exigences de scientificité des revues académiques (voir plus bas), ils ne furent jamais considérés par la communauté comme de « vraies » publications et ne furent de ce fait jamais cités. On m’a rapporté deux cas où soit l’évaluateur de l’article, soit l’éditeur de la revue demandèrent à l’auteur de retirer sa référence à un des textes de ce site, « car ce n’était qu’un blog ». Je pense que le problème reste entier, au moins en anthropologie – ce qui ne manque pas de décourager d’éventuelles initiatives. L’auto-publication constitue dans ces conditions un luxe et il est probablement nécessaire de le réserver à ceux qui en ont les moyens statutaires.
De plus, alors que je croyais, pendant les premières années, être en quelque sorte un pionnier qui expérimentait, parmi d’autres, un nouveau mode d’écriture scientifique, affranchi de ses contraintes institutionnelles inutiles, je pense maintenant, après avoir vu tant de sites de chercheurs s’ouvrir et se fermer peu après, ou se limiter à de l’auto-promotion (comme moi désormais), qu’il y a là quelque chose comme une impasse ou, au mieux, comme la possibilité d’une passade. Impasse car finalement ce site n’aura été qu’un véhicule de prépublication dont les textes furent retirés au rythme de leur reprise par d’autres éditeurs ; passade car, si son ouverture et son usage m’ont donné une liberté créative extraordinaire – le rêve de tout chercheur –, ses limites intrinsèques en termes de format, de lisibilité, de reconnaissance institutionnelle, de relations contractuelles avec les éditeurs, ont transformé cette expérience en une idylle temporaire, épuisée au bout de quelques années.
Tous les textes de recherche auto-publiés ici ont donc été par la suite publiés ailleurs, à deux ou trois exceptions près ; c’est d’ailleurs pourquoi le site s’est peu à peu vidé. Quels furent les débouchés éditoriaux de ces textes ? Trois ont été intégrés à des projets de création artistique, trois sont devenus des chapitres d’ouvrages collectifs, quatre ont paru dans des revues généralistes et huit ont été publiés par des revues scientifiques dites « à comité de lecture ». L’éventail est donc large et montre que des textes que j’ai conçus et écrits avec des critères identiques ont pu faire leur chemin dans des cadres éditoriaux pourtant très différents. D’autres textes de ce site ont quant à eux fait l’objet de livres : Lettres mortes en reprend une vingtaine (souvent allégés, hélas, de leur iconographie), Repartir de zéro trois (très augmentés), les Écrits d’Alfonso García Téllez un (la préface), L’Enchâssement neuf et le Traité des mondes factices quatre. Là encore l’éventail est large : éditeur universitaire dit « à comité de lecture », éditeurs indépendants et grands éditeurs commerciaux. Faut-il en conclure que lorsqu’un chercheur a montré à sa communauté, pendant suffisamment d’années, qu’il sait respecter les exigences standard de la scientificité, on peut lui faire confiance et le laisser libre de publier où il veut et comme il veut ?
Dernier point, celui du lectorat. On aura remarqué que je tiens à appeler ce site un « site » et non un « blog ». C’est que depuis les tout premiers jours j’ai voulu éviter d’entretenir la confusion qui voudrait qu’un chercheur publie de la science dans des revues et de la vulgarisation, voire de simples opinions, sur son blog. L’idée que les blogs n’étaient que des tribunes généralistes, plus ou moins paresseusement étayées, était encore très répandue lors des premières années du site : c’était avant que ce genre de blogs disparaisse massivement, déserté en premier lieu par la communauté académique qui découvrit que ses opinions n’étaient la plupart du temps pas beaucoup plus intéressantes que celles des autres. Aujourd’hui la grande majorité des blogs de chercheurs, par exemple les carnets Hypothèses, appartiennent à un tout autre genre : ils prennent la forme de lieux d’accompagnement de la recherche, c’est-à-dire de vulgarisation, de promotion et de logistique. Je crois avoir montré que je n’ai pas considéré les choses de cette manière et que, pendant ses cinq premières années, ce site a été pour moi, plutôt qu’une tribune d’opinions ou une plateforme de vulgarisation (de « valorisation » comme on dit), un espace de recherche au sens plein du terme ; il est vrai que j’ai échoué à faire accepter ce principe à la communauté académique – qui ne commença à citer et à discuter les textes de ce site, c’est-à-dire à reconnaître leur existence, qu’une fois qu’ils furent publiés sous forme d’articles ou de livres.
En raison de la technicité de son contenu, le site n’appelait pas un large lectorat, au contraire. Pendant les cinq années durant lesquelles je publiais régulièrement, la fréquentation s’est stabilisée à une moyenne de trente visiteurs par jour ; les cinq années suivantes, alors que je ne publiais quasiment plus et que je multipliais, à la demande des éditeurs, les dépublications, la fréquentation s’est gentiment maintenue à une petite quinzaine de visiteurs quotidiens. Mes statistiques (rudimentaires) me disent que depuis sa création le site a reçu à peu près trente mille visiteurs uniques et que ses textes ont été lus à environ soixante-cinq mille reprises ; beaucoup de visiteurs s’étaient vraisemblablement égarés, beaucoup de textes n’ont très certainement pas été lus passées les trois premières lignes. Sans surprise, les articles les plus populaires sont ceux où apparaissent des personnalités connues (Claude Lévi-Strauss et Hélène Smith, on appréciera la juxtaposition). Plus étonnant, le texte où je décortique l’écriture Mandombe est demeuré l’un des plus consultés : à peu près toutes les visites proviennent du Congo-Kinshasa et je soupçonne qu’il est utilisé comme un manuel d’apprentissage pour cette écriture à la sémiotique très complexe – c’est pourquoi je l’ai laissé sur le site malgré sa publication dans L’Enchâssement. La plupart des lecteurs viennent toutefois de France, sauf en 2022 lorsque les États-Unis, après avoir été d’éternels seconds, sont finalement devenus majoritaires (ce qui est peut-être un indice de la généralisation de l’usage de VPN générant des IP localisées aux États-Unis ?). D’une manière générale, ce lectorat est resté pour moi un mystère : je n’ai que très peu d’échos d’expériences de lecture et ceux-ci viennent la plupart du temps, enveloppés dans l’évidence de l’implicite, au détour d’une conversation avec quelqu’un, proche ou non, dont j’ignorais totalement qu’il me lisait, parfois depuis plusieurs années.
En voilà assez pour ce bilan, je crois avoir fait à peu près le tour de la question. J’en profite cependant pour remercier encore une fois Aaron Swartz – qu’il repose en paix – et Julian Assange – libérez-le ! Ils furent les figures tutélaires du rêve, désormais révolu, que représenta pendant un temps ce site où tout s’écrit et tout se lit à contretemps, soit trop tard, soit trop tôt.